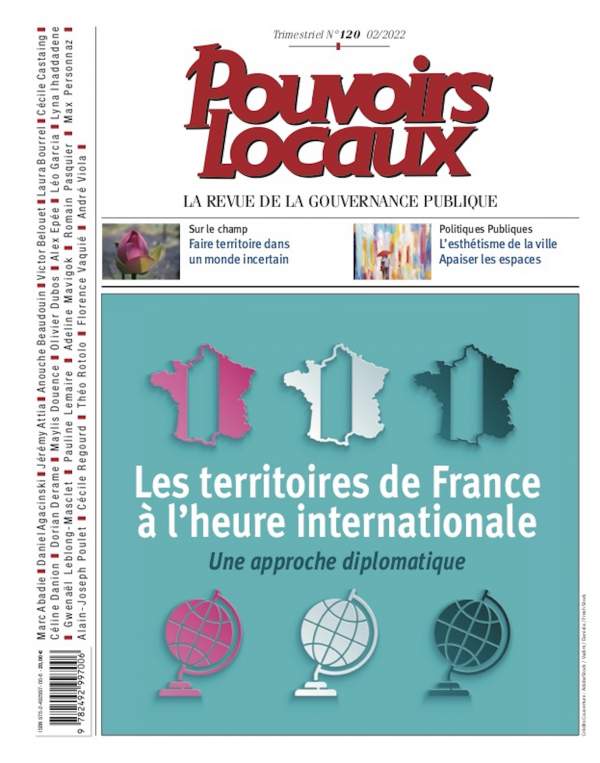Les relations centre-périphérie en temps de pandémie
La crise sanitaire paraît ainsi pousser à son paroxysme les traits de l’État unitaire en France et des relations entre l’État et les collectivités territoriales qui en découlent, comme si cette crise soulignait un hiatus entre le discours juridique relatif au droit commun et la réalité juridique imposée par l’urgence sanitaire. Celle-ci opère une certaine reconfiguration des responsabilités institutionnelles.
L’uniformité, parfois revêtue des habits lexicaux de la « verticalité », s’est manifestée, d’abord, dans le monopole décisionnel des représentants de l’État mais aussi dans les aléas de la mise en œuvre territorialisée des mesures édictées. La même urgence sanitaire a entraîné une reconfiguration des responsabilités institutionnelles. La relégation des collectivités territoriales à un rôle subordonné, se manifestant davantage en termes factuels qu’en termes juridiques, a correspondu à l’émergence parallèle de nouveaux acteurs institutionnels détachés du local.
La rubrique “Droit” est dirigée par Jacques Caillosse.
Le 14 juin 2020, dans son allocution mettant fin au premier confinement imposé dans le cadre de la crise sanitaire, le Président de la République, Emmanuel Macron, dressait un premier bilan des mesures prises pour endiguer la propagation du virus COVID-19. Il formulait son souhait « de bâtir de nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsabilités […]. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris ».
Par cette formule, le chef de l’État semblait alors réinterroger les relations entre le centre et la périphérie. Le centre ne constitue certes pas une catégorie juridique, néanmoins il est saisi par le droit dès lors « qu’il est partout derrière le local qu’il produit, découpe et retaille en fonction des circonstances »1. Le centre ne saurait évidemment pas se limiter à une acception a contrario par opposition au local dans la mesure où « le local reste un mode d’ancrage territorial de l’État »2. Au-delà de cette opposition centre-périphérie, l’affirmation du chef de l’État incitait donc à questionner plus spécifiquement les relations entre l’État et les collectivités territoriales : « je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent aux plus près de nos vies […] à nos maires ».
À l’image des réformes décentralisatrices qualifiées en termes d’ « actes », la crise sanitaire s’analyse métaphoriquement en termes de « vagues », correspondant aux confinements ou couvre-feu successifs. La première vague s’est caractérisée par une réponse uniforme de l’État : le confinement général et absolu sur l’ensemble du territoire national. Une telle réponse était alors révélatrice de la centralité étatique en France qui « se constitue à partir d’institutions et de fonctions qui se rapportent à la production de l’intérêt général. Le centre existe là où se fabrique l’intérêt général »3. L’État apparaît alors comme seul garant de l’intérêt général. En dépit d’une situation sanitaire différenciée, voire contrastée, selon les territoires locaux, est imposé, uniformément, le confinement. À contre-courant du discours dominant de ces dernières décennies, le principe d’uniformité retrouvait alors, paradoxalement, sa pleine effectivité.
Néanmoins, parmi les leçons tirées par le chef de l’État de ce premier confinement figurait la nécessité de favoriser une différenciation territoriale, d’accroître les responsabilités et les pouvoirs notamment des maires. À cet égard, ce choix paraissait s’inscrire dans la continuité de la réforme territoriale entreprise à partir de 20144. Il a pu sembler partiellement conforté en septembre et octobre 2020 lors des échanges entre les acteurs des grandes métropoles et l’Élysée. Qu’il s’agisse du discours ou de la méthode, la crise sanitaire paraissait de nature à renouveler les relations Etat-collectivités territoriales.
Il n’en fut rien. Le 28 octobre 2020, le chef de l’État a imposé un nouveau confinement sur l’ensemble du territoire national suscitant un grand nombre de réactions, notamment des élus locaux et plus particulièrement des maires. Conjointement, la crise sanitaire n’a pas épargné les conditions d’exercice de la démocratie locale. Si le premier tour des élections municipales a été maintenu, il en fut différemment du second5. A l’heure ou sont écrites ces lignes, des interrogations subsistent quant aux échéances des élections régionales et départementales6.
La crise sanitaire paraît ainsi pousser à son paroxysme les traits de l’État unitaire en France et des relations entre l’État et les collectivités territoriales qui en découlent, comme si cette crise soulignait un hiatus entre le discours juridique relatif au droit commun et la réalité juridique imposée par l’urgence sanitaire. Celle-ci opère une certaine reconfiguration des responsabilités institutionnelles.
De l’urgence sanitaire au retour du principe d’uniformité
L’uniformité, parfois revêtue des habits lexicaux de la « verticalité », s’est manifestée, d’abord, dans le monopole décisionnel des représentants de l’État mais aussi dans les aléas de la mise en œuvre territorialisée des mesures édictées.
Formalisme du discours sur la différenciation et effectivité de la verticalité décisionnelle
La crise sanitaire a été l’occasion de remettre sur le devant de la scène la question de la pérennité du principe d’uniformité, ayant caractérisé l’organisation territoriale française. Ce principe est depuis plusieurs décennies décrié, jugé inadapté aux exigences de la modernité. La réforme territoriale, depuis 2014, en a considérablement réduit la portée, notamment par la création des métropoles et leurs statuts particuliers7. Cette remise en cause devait, ou devrait, être accentuée encore par le projet de révision de la Constitution8, et par le projet de loi initialement dit des 4 D (décentralisation, déconcentration, différenciation, décomplexification) dont les principes ont été en quelque sorte réaffirmés, selon d’autres voies, dans le contexte même de la pandémie par l’adoption au Sénat, le 3 novembre 2020, d’un projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 16 mars 2021 avant que le Conseil constitutionnel ne soit saisi par le Premier ministre deux jours plus tard.
À cet égard, la crise sanitaire aurait pu constituer une occasion de poursuivre cette volonté politique en laissant le soin aux collectivités territoriales de déterminer les mesures propres à endiguer la propagation du virus sur leurs territoires respectifs, ou, a minima, à les associer à l’édiction de ces mesures. La réalité offre un net contraste avec de telles énonciations.
L’état d’urgence sanitaire pour l’ensemble du territoire national a été initialement déclaré par décret en Conseil d’État, et prolongé par la voie législative, dès lors qu’il s’appliquait au-delà de la durée d’un mois9. Telle fut la portée de la loi du 23 mars 202010, puis plusieurs textes successifs ont prorogé la période concernée. La loi du 14 novembre 202011 a notamment prolongé cet état d’urgence jusqu’au 16 février 2021 puis une nouvelle prolongation a été décidée jusqu’au 1er juin 2021. Ce régime de l’état d’urgence sanitaire ne concerne que les mesures prises pour gérer la pandémie de la COVID 19. Il vise le cas de « catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».
S’agissant des relations avec les collectivités territoriales, la question première est celle de la dévolution des pouvoirs pour édicter les mesures exigées par la crise sanitaire. Sur ce terrain, la solution retenue n’offre guère de nuances : il s’agit d’une concentration des pouvoirs dans les seules mains de l’exécutif national. Il appartient au Premier ministre d’édicter par décret les mesures expressément énumérées par la loi incluant le confinement à domicile, l’interdiction des rassemblements, les limitations nécessaires à l’exercice de la liberté d’entreprendre. À titre complémentaire, le ministre de la santé est compétent pour prendre, par voie d’arrêtés, les autres mesures générales et individuelles. Enfin, les préfets peuvent être habilités à édicter des mesures d’application limitées à une partie du territoire. Sur ce terrain de l’attribution des compétences durant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la pandémie, le pouvoir de décision est donc purement national, ou si l’on préfère, centralisé. Le caractère décentralisé de la République, proclamé par la Constitution12, étant en l’occurrence réduit à néant et laissant libre cours au seul caractère unitaire de l’État.
Un deuxième niveau d’analyse concerne les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en termes soit d’application unitaire des mêmes mesures sur l’ensemble du territoire national, soit, à l’inverse, d’application différenciée selon les différents territoires locaux, éventuellement plus ou moins gravement concernés par les manifestations de la pandémie. Sur ce deuxième terrain, la doctrine de l’exécutif a connu plusieurs évolutions même si la prévalence de l’uniformité a prévalu.
Les aléas de la territorialisation des mesures d’application
À l’issue du premier confinement, le chef de l’État avait affirmé que face aux inégalités territoriales, tout ne pouvait plus être décidé depuis Paris. C’est ainsi que lors de la reprise de la pandémie, en septembre 2020, le gouvernement affichait une recherche de dialogue avec les élus locaux et plus particulièrement avec ceux des grandes métropoles, pour une différenciation éventuelle des mesures d’application selon les territoires et leurs rapports avec les effets de la pandémie. Cette déclaration d’intention devant être mise en œuvre dans le cadre juridique fixé par la loi d’urgence sanitaire.
Dès la première période de confinement, cette volonté de dialogue était demeurée, en réalité, elle-même encadrée dans le cadre d’un premier dispositif dit de zonage qui visait ainsi à constituer une réponse à la crise sanitaire en divisant le territoire selon la typologie des « zone hors alerte », « zone d’alerte », « zone d’alerte renforcée », « zone d’alerte maximale »13. Les mesures prises pour lutter contre la pandémie variaient donc selon la catégorie dont relevait chaque territoire. Les « zones d’alerte maximale » et des « zones d’alerte renforcée », identifiées par un fort taux d’incidences, faisaient ainsi l’objet d’une série de mesures particulièrement restrictives telles que l’interdiction de rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public, l’interdiction des fêtes locales ou étudiantes, ou la fermeture des salles de sport…
Une telle démarche de territorialisation du droit a fait l’objet de vives critiques notamment s’agissant des critères retenus pour réaliser ce zonage. La contestation au sein de la métropole Aix-Marseille lors de son passage en zone d’alerte maximale, fin septembre 2020, en témoigne. La maire d’Aix-en-Provence, contestant son classement sur la « liste noire » au motif que les statistiques ayant justifié ce classement ne correspondaient pas aux chiffres relevés localement, a pu ainsi déclarer que « la haute administration est en train de devenir folle ». Le ministre de la santé, Olivier Véran, justifiait le délai supplémentaire accordé à Paris avant d’être placé en zone d’alerte maximale par l’absence de franchissement des seuils fatidiques à la date du basculement d’Aix-Marseille. Il soulignait conjointement que « Marseille a été basculée en zone d’alerte maximale alors qu’elle avait franchi les seuils depuis plus longtemps que les 24 heures de délai ». À cet égard, la crise sanitaire constitue une occasion supplémentaire d’observer les obstacles pour opérer une différenciation territoriale dès lors que celle-ci est imposée d’office, pour ne pas dire de manière autoritaire, par l’État.
D’autres territoires métropolitains, bien que non placés en zone d’alerte maximale, ont fait l’objet de mesures restreignant les libertés par arrêté préfectoral en application du décret du 10 juillet 2020. Ces mesures ont suscité de vives contestations notamment sur le terrain contentieux. C’est ainsi, par exemple, que le Tribunal administratif de Toulouse a été saisi en référé de la mesure d’interdiction d’accueil du public dans les salles de sport et gymnases situés sur le territoire de Toulouse et de son aire urbaine. Les requérants demandaient sa suspension au motif qu’elle porterait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par une ordonnance en date du 2 octobre 2020, le Tribunal administratif a fait droit à cette demande soulignant que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas indiqué dans son arrêté « en quoi la propagation du virus serait à craindre particulièrement dans les salles de sport et gymnases » et que par conséquent « il n’est pas démontré que la mesure de fermeture totale de ces établissements soit nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus »14. Solution, favorable au local, sans lendemain. Comme en témoigne par exemple la décision en référé du Tribunal administratif de Rennes, le 30 septembre 2020, ayant suspendu l’arrêté préfectoral interdisant l’accueil du public dans les salles de sport et gymnases situés sur le territoire de Rennes Métropole pour la période du 26 septembre au 10 octobre 202015. Elle a fait l’objet d’un appel devant le Conseil d’État pour lequel ce dernier n’a pas eu à statuer dans la mesure où la suspension avait cessé de produire effet à la date de l’ordonnance16.
Quelques semaines plus tard, le Conseil d’État a rejeté la demande de professionnels du sport de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône relative à la fermeture des établissements sportifs17, confirmant la décision rendue en première instance18. Il a justifié sa décision en soulignant, d’une part, que Marseille et Aix-en-Provence sont en « zone d’alerte maximale » où le taux d’incidence est élevé et la capacité en réanimation réduite et, d’autre part, par le fait que la pratique d’une activité physique – de surcroît en lieux clos – favorise la circulation du virus en dépit d’un protocole sanitaire, selon le Haut Conseil de la santé publique. De la même manière, le Conseil d’État a rejeté la demande des collectivités territoriales et organisations représentatives du secteur économique des sports d’hiver de suspendre la décision de fermeture au public des remontées mécaniques des stations de ski19.
Par la suite, à compter de la « deuxième vague » de la pandémie, les périodes de confinement, ou de couvre-feu, se sont appliquées durant plusieurs semaines, sur l’ensemble du territoire métropolitain selon des modalités identiques, jusqu’à la plus récente période de couvre-feu après la mi-février 2021 caractérisée par une progression de la pandémie très accentuée dans certains territoires, en particulier la métropole de Nice et des Alpes-Maritimes, la ville de Dunkerque, puis le Pas-de-Calais, nécessitant l’aggravation des mesures appliquées à l’ensemble du territoire national, en imposant un confinement spécifique durant les week-ends.
Encore convient-il de relever que, d’une part, cette différenciation n’a été que de portée relative : un confinement spécifique durant plusieurs week-ends se superposant au couvre-feu à partir de 18 heures concernant l’ensemble du territoire national et, d’autre part, que les zones territoriales concernées par cette mesure spécifique n’étant pas nécessairement définies en fonction des limites territoriales d’une collectivité déterminée mais soit en fonction d’une identification proprement géographique relative, par exemple, à la zone littorale autour de Nice concernant une soixante de communes, soit par la prise en compte simultanée d’une diversité de départements (23) situés dans des zones différentes de l’hexagone. La logique même de la territorialisation a donné lieu à de vives critiques dès lors que des zones tout aussi gravement atteintes (l’Ile-de-France) avaient échappé à ces mesures plus restrictives.
Par la suite, l’importance des disparités territoriales a contraint l’exécutif à prendre de nouvelles mesures spécifiques additionnelles dites de « freinage » à l’égard d’une diversité de départements (fermeture de commerces supplémentaires)… avant de revenir début avril à un régime uniforme pour tout le territoire national hexagonal.
Dans ce cadre général, hors la stricte appréhension des dispositifs juridiques en termes de compétences, la question se pose alors de la place résiduelle accordée aux collectivités territoriales.
De l’urgence sanitaire à une reconfiguration des responsabilités institutionnelles
La relégation des collectivités territoriales à un rôle subordonné, se manifestant davantage en termes factuels qu’en termes juridiques, a correspondu à l’émergence parallèle de nouveaux acteurs institutionnels détachés du local.
La relégation des pouvoirs locaux en période de crise
L’invocation du couple « Préfet-Maire » est, pour l’essentiel, restée une figure rhétorique, les échanges en forme d’information, de concertation, n’ayant jamais suscité un authentique partenariat décisionnel, même réduit à la délimitation des zones d’application spécifique.
Le pouvoir de police des maires, pas plus que la clause générale de compétences pour les communes, ou les compétences spécifiques en matière sanitaire des départements, ne leur ont offert un rôle plus notable que celui des régions. Les initiatives prises par les différentes collectivités territoriales se sont donc organisées non point sur le terrain des prescriptions juridiques mais sur le seul terrain des exigences factuelles et politiques de l’intérêt public local, réduisant à néant la dichotomie chère aux juristes et source d’inépuisables analyses autour de la portée de la clause générale de compétence.
Sur ce terrain factuel, les métropoles, comme les régions ou les départements, et la généralité des communes, se sont ainsi mobilisées pour fournir des masques à leur population lorsque la maîtrise de cet approvisionnement par les services de l’État s’est avérée défaillante ou, ensuite, pour la mise en place opérationnelle des lieux de vaccination. Marginalisées sur le front principal de la prise de décisions stratégiques contre la pandémie, les collectivités territoriales ont, à l’inverse, montré leur capacité d’intervention en termes de protection sanitaire et sociale des populations les plus fragiles, de fonds de soutien aux entreprises en difficulté, de correction des carences de l’action de l’État, s’agissant de l’approvisionnement en masques ou de mise en place de tests. S’agissant de la fourniture de vaccins, les annonces faites par plusieurs régions de passer directement commande aux laboratoires ne purent dépasser le stade de proclamations politiques proprement velléitaires.
La critique de responsables locaux à l’encontre de la « verticalité » ressort assez bien de la manière dont le gouvernement a, par exemple, traité les propositions conjointes de l’ensemble des régions. L’association des régions de France a, ainsi, avancé neuf propositions pour accélérer et réussir la campagne des vaccinations le 6 janvier 2021. Deux seulement, de moindre portée, ont été retenues. En s’associant au sein de « Territoires unis » avec des départements et des communes, elles avaient dès le 25 novembre 2020 proposé au gouvernement de se mettre à sa disposition pour accompagner cette campagne. Mais Régions de France a dû conclure que « malheureusement aucune des réunions mises en place dans ce cadre n’a permis de co-construire quoi que ce soit. Elles n’ont été que des boîtes d’enregistrement. Le ministère de la santé a souhaité organiser et décider seul de la stratégie et des actions à mener »20. Dans la période antécédente du premier déconfinement, le Président du Sénat et les Présidents des trois grandes associations d’élus (AMF, ADF, RF) avaient, selon la même inspiration, proposé « 12 mesures prioritaires pour un déconfinement réussi »21, n’ayant pas davantage produit d’effectivité décisionnelle…
Défaite plus spécifique du pouvoir municipal si l’on admet avec le professeur E. Picard que cette « fonction propre » de police signifie « initialement deux choses : d’une part, que cette fonction ou ce pouvoir appartenait en propre, par nature et à raison de son objet, aux municipalités et non à l’État ou à l’Administration générale ; d’autre part, que le fondement de cette fonction ou de ce pouvoir ne procédait pas vraiment de la loi, mais de l’existence d’une association communale quasi privée : en ce sens, ce pouvoir était autonome par rapport à la loi »22. De cette conception découlait la place substantielle accordée aux pouvoirs de police dans la théorie du pouvoir municipal. Selon L.-J. Chapuisat « on peut même avancer qu’à la limite, la philosophie du pouvoir municipal, conduit à n’accepter de véritable police que municipale. Le reste est sûreté générale et protection des intérêts supérieurs de la Nation »23. Mais depuis plusieurs décennies, « le pouvoir de police générale, dans l’exercice duquel le maire se trouvait occuper une place privilégiée, s’est […] progressivement dépouillé de sa réalité par un mouvement constant et unilatéral de transfert aux autorités préfectorales et gouvernementales »24. La crise sanitaire a considérablement aggravé cette évolution.
Le décret du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux ou il a été prorogé, consolidait le pouvoir de police du préfet en l’habilitant à prendre une série de mesures restreignant les libertés. À l’inverse, le décret du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et les arrêtés préfectoraux en la matière encadrent drastiquement la compétence du maire.
Face à une telle dépossession de leur compétence, un certain nombre de maires ont édicté des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture de commerces sur leur commune, mais ils ont été logiquement invalidés par la juridiction administrative. C’est ainsi, par exemple, que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu les arrêtés pris par les maires de Béziers, Perpignan, Carcassonne, Claira et Pia autorisant l’ouverture des commerces non-alimentaires situés sur tout ou partie de leur territoire rappelant, d’une part, que le maire ne peut prendre que des mesures plus restrictives que celles adoptées par les autorités compétentes de l’État25 et que les mesures complémentaires pouvant être prises doivent être justifiées par des « raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État »26.
Il en est ainsi car la période de crise ne saurait être comprise à travers le prisme du droit ordinaire. Cette situation avait été analysée par le professeur J. Caillosse27. Il rappelait ainsi qu’« en France, le droit a longtemps imposé l’idée que gérer les crises était une affaire locale » et que la commune était considérée comme « l’échelon le plus approprié du traitement administratif des accidents et autres fléaux calamiteux »28. Mais c’était pour mieux souligner qu’en cas de risque majeur la protection des populations peut difficilement être « livrée aux jeux des solidarités locales », et que dès lors que l’affaire est nationale, c’est bien au niveau de l’État qu’il convient de la gérer29. Ainsi en période de crise grave, y aurait-il une nécessité à ce que « le droit ordonne le ré-investissement et la maîtrise du territoire local par les autorités de l’État »30, comme si « le droit commun de la décentralisation [était] appelé à s’effacer derrière une sorte de droit d’urgence »31. En conclusion, « l’éventualité de catastrophe de grande ampleur exige le resserrement par le haut de l’ensemble des dispositifs de sauvegarde et de secours »32. Dans la même contribution, est également dressé le constat selon lequel en période de grave crise, les territoires à privilégier correspondent plus directement à la notion de « zones », illustrant l’adaptabilité et la flexibilité de l’organisation juridique33.
L’actualité du propos concerne aussi « les réactions en défense de la part du « local » »34. Il eut été possible d’instituer un – ou des – comités de suivi composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées. Tel ne fut nullement le cas. Pourtant, dresser le simple constat de cette modalité de centralisation paraît en l’occurrence réducteur : les modalités de la centralisation mise en œuvre paraissent mériter d’être prises en compte dès lors qu’elles se sont caractérisées par l’émergence de nouvelles structures, en quelque sorte substituées aux collectivités territoriales.
L’émergence de nouveaux acteurs institutionnels
Les modalités d’exercice du pouvoir décisionnel de l’exécutif central s’agissant du traitement de cette pandémie rendent compte d’une configuration spécifique de l’État. Celle-ci s’est exprimée selon une conception fondée sur le rôle majeur d’instances extérieures au traditionnel partage des compétences étatiques, et dont il ne paraît pas excessif d’y voir des protagonistes en l’occurrence substitués à une logique de meilleur partenariat avec les collectivités territoriales ou dont le rôle paraît antinomique d’une meilleure prise en compte des problématiques proprement locales.
Il en va ainsi, d’abord, de la mise en place d’un conseil scientifique composé d’éminents professeurs de médecine et opérant une forme de dualité représentative pour gérer la crise entre pouvoir politique et pouvoir médical ou sanitaire. Ce cénacle d’expertise scientifique et médicale chargé d’orienter, de conseiller, le pouvoir exécutif en fonction de l’évolution de la pandémie, est par nature émancipé des questions territoriales, même si une controverse entre scientifiques a pu, un temps, alimenter une opposition Paris-Marseille, la figure emblématique d’un épidémiologiste extérieur audit conseil scientifique s’opposant frontalement à certaines de ces préconisations.
Il en va ainsi, surtout, du rôle prépondérant alloué au Conseil de défense, exprimant directement le contexte de crise, dérogatoire au fonctionnement normal des institutions, selon les postulats d’une souveraineté resserrée autour de l’exécutif présidentiel. Il en va, aussi, enfin, d’une manière en apparence plus singulière, sinon paradoxale, de l’externalisation vers des groupes privés d’une mission de consultation stratégique paraissant exprimer dans ce contexte de crise la figure de la « start-up station » par ailleurs revendiquée comme facteur de croissance.
Ces deux éléments paraissent mériter un examen spécifique alors que la création ultérieure, sous les auspices d’une référence à la démocratie participative, d’un comité citoyen de 35 personnes tirées au sort, chargé de contrôler le processus de vaccination n’est, en revanche, apparue que comme un non-sujet, hors le champ éventuel de la communication.
La place centrale prise par les réunions du Conseil de défense, marginalisant le Parlement, et, pour partie le gouvernement, fournit un raccourci pour comprendre la mise à l’écart des collectivités territoriales des processus de délibération décisionnels et des orientations stratégiques réservés à ce Conseil.
Au cours de l’année 2020, le Président de la République a réuni plus de quarante Conseils de défense, suscitant de vives critiques politiques quant à l’adéquation entre traitement de la pandémie et la logique de « secret-défense » présidant aux réunions de ce Conseil de défense issu du Conseil dit de défense et de sécurité nationale prévu à l’article 15 de la Constitution et dont les modalités d’exercice sont définies par le décret du 24 décembre 200935.
La prévalence du Conseil de défense durant la gestion de la pandémie renvoyait pour l’essentiel à l’image d’un État resserré autour précisément des impératifs de défense et de sécurité pour affronter une authentique « guerre » sanitaire selon les propres mots du Président de la République, et limitant dans son fondement même la possibilité d’initiatives locales.
Ce contexte, marqué par une empreinte particulièrement régalienne, n’a pas, pour autant, remis en cause la figure d’une éventuelle « start-up nation », revendiquée durant la période précédente et ayant suscité quelques controverses politiques complémentaires. Elle conduit, en effet, à s’interroger sur l’état des forces administratives en interne, dans un domaine défini comme d’ordre régalien s’agissant des enjeux considérables sur le terrain de la santé publique.
C’est ainsi, par exemple, que le cabinet Kinsey et Company a été sollicité pour la définition du cadrage logistique et la coordination opérationnelle de la politique de vaccination36, avant que le cabinet Accenture ait été mobilisé pour le lancement et l’accompagnement du système d’information COVID recensant les données relatives aux personnes vaccinées, ou que les cabinets Citwell et JJC interviennent auprès de Santé Publique France pour l’accompagnement logistique et la distribution des vaccins…
Ces différentes externalisations, très prégnantes dans cette situation de crise, ont été mises en œuvre sur le fondement de l’Accord-cadre de la délégation interministérielle à la transformation publique portant en titre « Prestations d’assistance à la conception et à la mise en œuvre opérationnelle de projets de transformation de l’action publique ».
Sur ce fondement, le ministère de la santé et des solidarités n’aurait ainsi que bénéficié d’un droit de tirage au titre du premier volet de cet accord intitulé « Stratégies et politiques publiques », à hauteur de 20 millions d’euros partagés entre le groupe Mc Kinsey et le cabinet Roland Berger et Boston Consulting Group37. Ce processus d’externalisation paraît initialement avoir été mis en orbite dans le contexte de l’adoption de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances), entrée en vigueur en 2006 et accentuée à partir du programme de la RGPP (Révision générale des politiques publiques). Cette pratique avait donné lieu à un rapport critique de la Cour des comptes en 2018, soulignant que « le recours mal maîtrisé » à ces externalisations « constitue une source de charges à plus long terme, en raison notamment de la perte de compétences des équipes qui en résulte »…
C.R
Phrases loupes
À l’image des réformes décentralisatrices qualifiées en termes d’ « actes », la crise sanitaire s’analyse métaphoriquement en termes de « vagues », correspondant aux confinements ou couvre-feu successifs.
La crise sanitaire a été l’occasion de remettre sur le devant de la scène la question de la pérennité du principe d’uniformité, ayant caractérisé l’organisation territoriale française.
En période de crise grave, y aurait-il une nécessité à ce que « le droit ordonne le ré-investissement et la maîtrise du territoire local par les autorités de l’État » ?
La crise sanitaire constitue une occasion supplémentaire d’observer les obstacles pour opérer une différenciation territoriale dès lors que celle-ci est imposée d’office, pour ne pas dire de manière autoritaire, par l’État.
L’invocation du couple « Préfet-Maire » est, pour l’essentiel, restée une figure rhétorique, les échanges en forme d’information, de concertation, n’ayant jamais suscité un authentique partenariat décisionnel
La critique de responsables locaux à l’encontre de la « verticalité » ressort assez bien de la manière dont le gouvernement a, par exemple, traité les propositions conjointes de l’ensemble des régions.
Notes de bas de page
1 J. Caillosse, Les « mises en scènes » juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire en droit public français, LGDJ, Droit et société 2009, p. 145. Cf. not. M. Agulhon, « Le centre et la périphérie », in P. Nora (dir.) Les lieux de mémoires : La République, la Nation, la France, Vol. 2, 1997 ; J. Chevallier (dir.), Centre, périphérie, territoire, CURAPP, 1979.
2 Ibid., p. 30.
3 Ibid., p. 155.
4 Cf. loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électorale, loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
5 Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.
6 Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.
7 Cf. not. L. Janicot, « Les métropoles à statut particulier : le Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille-Provence », AJDA, 2014, n°11, pp. 613-618, N. Kada, « Métropoles : vers un droit (peu) commun ? », AJDA, 2014, n°11, pp. 619-624.
8 Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace n° 911, 9 mai 2018.
9 En l’occurrence et par dérogation déclaré initialement pour deux mois sur l’ensemble du territoire.
10 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid 19.
11 Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
12 Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
13 Zones respectivement dites vertes, roses, rouges…
14 TA Toulouse, Ord. 2 octobre 2020, n° 2004831, 2004851, 2004861, 2004869.
15 TA Rennes Ord. 30 septembre 2020 n° 2004134, 2004141, 2004160.
16 CE Ord. 21 octobre 2020 n° 445314.
17 CE Ord. 16 octobre 2020 n° 445102, 445186, 445224, 445225.
18 TA Marseille Ord. 2 octobre 2020 n° 2007348, n° 2007349, n ° 2007350,
19 CE Ord. 11 décembre 2020 n ° 447208.
20 Régions de France, Communiqué de presse Propositions des Régions de France pour accelérer et réussir la campagne de vaccination dans notre pays, 6 janvier 2021 disponible à l’adresse suivante https://www.normandie.fr/sites/default/files/2021-01/CP%20vaccination.pdf.
21 12 mesures prioritaires pour un déconfinement réussi et permettre aux collectivités territoriales de jouer leur rôle au service des Français adreséées par le Sénat au Gouvernement en coordination avec l’AMF, l’ADF, et Régions de France, 29 avril 2020, disponible à l’adresse suivante https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=2c99d3ed915f7ae1fc24c21dbfb2820c.pdf&id=40098
22 E. Picard, La notion de police administrative, Thèse Paris II, 1978, p. 27. Henrion de Pansey, Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes, E.V. Foucart, 4ème éd., 1840 p. 29-30.
23 Ibid.
24 L.-J. Chapuisat, La notion d’affaires locales en droit administratif français, op. cit., p. 37.
25 Ce qui fut réalisé dans certaines communes comme à Nice, en sus des mesures aggravées prises par l’exécutif.
26 TA Montpellier Ord. 4 novembre 2020 n° 2004875, 204876, 2004877, 204879. Dans le même sens cf. TA Toulouse Ord. 9 novembre 2020 n° 2005497.
27 J. Caillosse, « Droit de crise, droit en crise ? » in C. Gilbert (dir.), La catastrophe, l’élu et le préfet, PUG, 1990, p. 43 et suiv.
28 Ibid p. 47.
29 Il relève à cet égard que la multiplication des polices spéciales relève de la même problématique de transfert du maire vers le préfet.
30 Ibid p. 48.
31 Ibid. p. 50.
32 Ibid. p. 53.
33 J. Charbonnier, Flexible droit, LGDJ, 1979
34 J. Caillosse, « Droit de crise, droit en crise ? », op. cit., p. 55.
35 Décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 relatif au conseil de défense et de sécurité nationale et au secrétariat général et de la sécurité nationale.
36 L’un des dirigeants pour le secteur public du groupe est l’un des auteurs de l’ouvrage L’Etat en mode start up, préfacé par E. Macron, Ed. Eyrolles, 2016.
37 Avis publié en juin 2019 au bulletin officiel des annonces des marchés publics. Selon le journal Le Point, le groupe Mc Kinsey serait ainsi rétribué à hauteur de 2 millions d’euros mensuels.