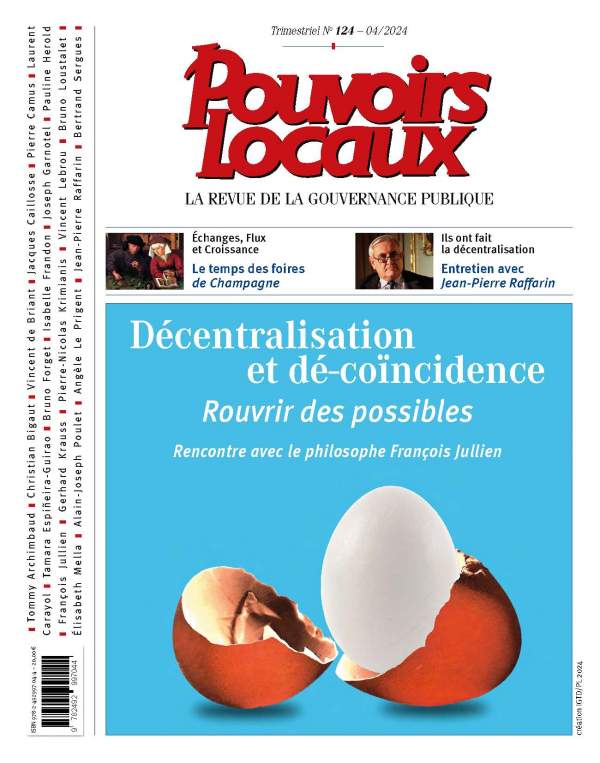La formation des élus locaux contre la mythologie républicaine : le dilemme de la complexification des mandats locaux (2e partie)
En 30 ans d’existence, la formation des élus locaux est restée à un stade embryonnaire. Seuls 3 à 5 % d’élus se formeraient chaque année. Il n’existe que très peu de données pour documenter cette faible pratique dans la mesure où le sujet n’a que très peu été investi scientifiquement et médiatiquement. Ce deuxième article se consacre à faire état de la situation actuelle du droit à la formation en considérant que le faible recours des élus locaux à la formation s’explique moins par le désintérêt que par les conditions de mise en œuvre du droit. Entre la difficulté de la définir clairement, les inégalités d’accès créés par les dispositifs eux-mêmes et les multiples tentatives de réformes, la formation des élus locaux demeure un objet problématique. Essentielle pour le bon exercice des mandats, son existence remet en cause, malgré elle, le caractère autosuffisant de la citoyenneté dans l’accès aux mandats locaux au profit de la notion de compétence, encore largement illégitime.
Réguler à l’aveugle ; la définition impossible de la formation des élus locaux
À partir des années 1990, la formation des élus se décline en deux politiques publiques complémentaires. La première, de nature incitative, structure les modalités pratiques d’accès et d’exercice du droit à la formation pour les élus (financements publics, droit d’absence etc.). La seconde, de nature réglementaire, organise le filtrage des organismes de formation. Plusieurs fois réformé et modifié, le droit à la formation des élus prend aujourd’hui la forme d’un système binaire, composé d’un côté par un financement obligatoire assuré par les collectivités territoriales (DFEL)1, et de l’autre par une cotisation versée par les élus locaux pour financer un droit individuel de formation (DIFe) 2. Le premier devant permettre aux élus de se former dans le cadre de leur mandat, le second pouvant financer au choix des formations liées à l’exercice des mandats ou destinées à faciliter la sortie du mandat et la reconversion professionnelle. Pour capter ces financements publics, les organismes de formation doivent au préalable recevoir l’agrément du ministère en charge des relations avec les collectivités territoriales 3 sur la base de l’avis rendu par le Conseil National de la Formation des Élus Locaux (CNFEL)4. De ce point de vue, le marché de la formation des élus peut être considéré comme une « prérogative d’État concertée ». Prérogative dans la mesure où le marché, basé sur des fonds publics, se resserre autour des seuls organismes dépositaires de l’agrément délivré par l’autorité publique. Concertée car les décisions ministérielles s’appuient sur les avis de cette instance consultative qu’est le CNFEL, représenté majoritairement par des élus locaux issus des principales associations représentatives 5 ainsi que des personnalités qualifiées (universitaires, représentants du Conseil d’État, etc.).
Situé au centre de cette gouvernance, le CNFEL reçoit une double mission. Premièrement, donner une « orientation générale à la formation des élus locaux », autrement dit de participer à circonscrire et objectiver l’ensemble des besoins de formation des élus locaux et les formes pédagogiques les plus appropriées à ce public singulier. Deuxièmement, définir une politique de régulation du marché de la formation, c’est-à-dire d’arrêter les critères permettant d’examiner les dossiers de candidature déposés par les organismes. Pour autant, le CNFEL n’accomplira aucune de ces deux missions. Cette difficulté se mesure très concrètement au travers de la variabilité des avis rendus entre 1994 et 2016 6.
Trois périodes se distinguent : deux phases de régulation singularisées par des taux de refus importants (1993-2003 et 2010-2016) entrecoupées d’une phase de régulation plus souple (2003-2010).
Graphique 1 : évolution des avis du CNFEL – 1res demandes
Clef de lecture : sur 100 décisions prises par le CNFEL au cours de son second mandat, 56 étaient défavorables, 34,8 favorables et 9,2 reportées.
Cette variation traduit la formalisation de trois paradigmes de régulation adoptés successivement dans le temps par les membres du CNFEL pour délivrer les agréments aux organismes de formation. Le premier, associé à l’entrée en fonction du Conseil, se construit autour d’une conception défensive du marché (1993-2001). Reprenant à leur compte la crainte de l’attractivité des financements publics, les membres se donnent pour rôle de protéger les élus et de limiter l’accès des organismes au marché. S’ils réussissent à définir un répertoire commun de critères pour évaluer les dossiers, la régulation qu’ils appliquent reste en grande partie informelle, reposant sur des doctrines orales définies et redéfinies en cours même d’examen.
À partir des années 2000, le premier modèle de régulation du marché évolue. Initialement rigoriste, l’installation du troisième Conseil fait entrer de nouveaux membres qui participent à renouveler progressivement les systèmes de représentation préalablement adoptés. En remettant en cause certaines représentations, l’action de ces nouveaux membres modifie l’action du CNFEL. D’une instance de filtrage et de surveillance, le Conseil réinvente sa posture régulatrice autour du rôle de « facilitateur ». En adoptant la croyance en l’autorégulation du marché et la rationalité des élus pour choisir les meilleures formations, l’objectif est désormais moins de contrôler a priori la qualité des formations que de laisser jouer les « lois » de l’offre et de la demande pour disqualifier les formations les moins pertinentes. Cette transformation de la posture du CNFEL assouplie les doctrines de refus des dossiers que les membres laissent plus aisément passer pour « faire leur preuve ».
Enfin, à partir des années 2010, cette parenthèse se referme. La dynamique d’assouplissement de l’agrément s’inverse ce qui se traduit par le décroît des avis positifs.
Ce nouveau changement ne doit toutefois pas se comprendre comme un simple abandon des théories d’autorégulation du marché. Ni d’ailleurs comme un retour aux principes initiaux de protection des élus et de leur droit de formation. La période qui s’ouvre à partir de l’année 2010 est plutôt un processus d’hybridation des modèles de régulation existants ; celui de protéger le marché et de faciliter son autorégulation. D’un côté, de nouvelles doctrines rigidifient l’accès à l’agrément et de l’autre, des postures de « laisser faire » se maintiennent.
Cette irrégularité de la régulation de CNFEL traduit, premièrement, la difficulté de définir clairement ce qui caractérise une « bonne » formation pour les élus locaux. Dans la mesure où les élus locaux sont loin d’être un groupe homogène, leurs besoins peuvent être tout à fait différents selon le type de mandat occupé, les cursus honorum empruntés, les responsabilités assumées, le moment du mandat, les évolutions législatives, les perspectives de maintien en poste ou d’anticipation de sortie, les expériences de formation initiales ou continues réalisées préalablement ou en parallèle du mandat etc. Deuxièmement, la variation des avis rendus par le CNFEL témoigne du caractère contradictoire de sa mission à savoir d’organiser un marché de formation pour que des élus puissent répondre aux injonctions liées à l’exercice de leur mandat sans pour autant reconnaître la fermeture des mandats autour d’une notion de compétence.
Autrement dit, s’il est de plus en plus nécessaire pour les élus locaux de se former pour exercer convenablement leur mandat, le caractère nécessaire de cette formation doit être euphémisé pour préserver la mythologie républicaine selon laquelle la citoyenneté est une condition suffisante pour être élu. Définir trop clairement ce qu’est la formation pour les élus, à quoi elle sert et comment elle doit être appliquée, et partant décliner une régulation du marché sur la base de critères objectifs et stables dans le temps, en viendrait à avaliser le processus de professionnalisation à l’œuvre et mettre en lumière les systèmes de sélections sociales, notamment la maîtrise de certaines compétences inégalement réparties, au principe de l’éviction d’un grand nombre de l’engagement électif.
Sans possibilité de définir ce que doit être la formation pour les élus sans entrer dans une démarche de désenchantement de la démocratie locale, les propriétés de la régulation opérée par le CNFEL se construisent alors « en acte » et évoluent dans le temps de manière non anticipée. Le corollaire étant que, mal défini, le recours à la formation est laissé aux inégalités de conditions d’exercice des mandats, empêchant la démocratisation de la pratique notamment chez les élus de petites et moyennes communes (Camus, 2022) dont l’accès aux dispositifs de formation n’est pas toujours possible.
Faciliter ou contrôler la demande ? Des dispositifs fondamentalement inégaux
Au-delà de la méconnaissance des élus de leur propre droit, l’un des principaux obstacles au recours des élus locaux à la formation est le caractère fondamentalement inégal des dispositifs auxquels ils peuvent recourir. Ce constat se mesure aussi bien pour le DFEL que pour le DIFe. Pour le droit issu des collectivités locales (DFEL), l’inégalité se situe au niveau de la répartition des moyens financiers selon la strate des collectivités locales. Dans la mesure où le calcul du budget de formation se réalise sur la base d’un pourcentage de l’indemnité annuelle des élus (compris entre 2 et 20 %), les élus ne disposent pas des mêmes capacités de financement selon la taille de la collectivité dans laquelle ils siègent. Un élu régional ou départemental dispose théoriquement de plusieurs milliers d’euros par année pour se former alors que les élus des petites communes ne peuvent compter, au mieux, que sur une ou quelques centaines7. Il faut ajouter à cela que 62 % des communes n’inscrivent même pas de budget8 de formation pour leurs élus. Ce qui démontre l’absence du contrôle des préfectures en la matière. Cette différence de moyen se recoupe avec les conditions d’exercice des mandats. Contrairement aux petites et moyennes communes, la grande majorité des élus régionaux et départementaux vit le mandat comme la source principale de revenu et dispose d’une affiliation partisane.
Ces deux éléments ne sont pas neutres au niveau de la pratique de formation. Dans la mesure où ils peuvent consacrer plus de temps à leur mandat et que chaque parti politique administre sa propre structure de formation, les élus régionaux et départementaux sont exposés à de fortes sollicitations pour se rendre disponibles et aller se former. Ces encouragements passent souvent par les entourages politiques (Demazière et Le Lidec, 2014) qui agissent comme des relais des organisations partisanes pour organiser et proposer des stages de formation aux élus des groupes politiques. De ce fait, si les élus locaux recourent peu au droit de formation issu de leur collectivité, c’est tout simplement que la grande majorité d’entre eux, dont 80 % siègent dans des communes de moins de 2000 habitants, ne disposent tout simplement pas, ou que de très peu de moyens financiers pour se former et de temps à consacrer spécialement à la formation.
Pour le DIFe, les choses sont un peu différentes. Pensé dès les années 2014-2015 par les parlementaires pour permettre aux élus de profiter d’un dispositif leur permettant de s’extraire de leur situation élective locale parfois peu propice à la formation, le DIFe se présente depuis 2022 comme une enveloppe annuelle de 400 €, distribuée à tous les élus, dont le cumul se limite à un plafond de 800 €. Pour les élus, deux usages sont possibles : soit se former au titre de leur(s) mandat(s), soit se former dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle. Toutefois, des possibilités de financements croisés existent. Par exemple, si un élu souhaite se former dans le cadre de son mandat mais qu’il ne dispose pas assez de moyens via son DIFe, il peut demander à sa collectivité de cofinancer jusqu’à 75 % du prix de la formation en question. Dans ce cas la collectivité doit s’inscrire sur la plateforme de la Caisse des Dépôts et Consignation pour s’enregistrer comme « organisme financeur » et mobiliser les droits DFEL pour son élu. Dans l’autre cas, si l’élu n’a pas soldé ses droits à la retraite et qu’il souhaite se former dans le cadre d’une reconversion professionnelle, il peut cette fois-ci utiliser tout ou partie de son Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer la formation.
Cependant, dans l’un ou l’autre des cas de figure, l’accès des élus au DIFe est particulièrement complexe ; il convient tout d’abord de s’inscrire sur la plateforme « moncompteformation.gouv.fr » au travers du dispositif « FranceConnect + », d’y retrouver ses droits (ou les réclamer en cas de problème 9), de prendre en main l’ergonomie de la plateforme pour rechercher les formations selon le statut souhaité (salarié, élu en mandat, élu en reconversion professionnel) et acheter la formation en utilisant une identité numérique « La Poste » précédemment créée. Pour pallier les diverses charges liées à la formation (déplacements, repas etc.), les élus doivent avancer les sommes et demander remboursements de manière dématérialisée. Autant d’étapes qui se transforment en obstacles pour des élus éloignés des pratiques numériques. Il y a en la matière une véritable rupture démocratique devant le droit à la formation des élus qui recoupe une fracture numérique. D’autant plus qu’il n’existe pas de plateforme d’aide directe administrée par la Caisse des Dépôts et Consignation pour aider les élus en demande, seulement des procédures par mail qui peuvent demander des jours, voir des semaines.
Cette difficulté d’accès des élus à la formation peut être considérée comme un dysfonctionnement. Mais également comme la résultante d’un choix précis d’instrumentation public permettant de réguler la demande. Car la formation pour les élus est une politique potentiellement très coûteuse. Si toutes les collectivités locales dépensaient chaque année 20 % de l’enveloppe indemnitaire annuelle, le DFEL représenterait une dépense de 2 milliards d’euros par mandats. Également, si tous les élus dépensaient les 400 € annuels de leur DIFe, la Caisse des Dépôts et Consignations devrait dépenser chaque année près de 200 millions d’euros alors qu’elle n’en récolte que 18 millions d’euros.
Autrement dit, le système actuel de formation pour les élus ne fonctionne que dans la mesure où ces derniers renoncent très majoritairement à utiliser leurs droits. Ce constat se vérifie également du côté des organismes de formation trop peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire pour répondre aux besoins. D’autant plus que la réforme de 202110 scinde désormais le marché en deux, en imposant à certains organismes de cumuler une double tutelle entre celle du CNFEL (ministère de l’Intérieur) et celle de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ministère du travail).
Un marché sous dimensionné en cours de dualisation
Dans le flux des demandes d’agrément et de renouvellement, le marché de la formation des élus locaux compte actuellement 240 organismes agréés, soit un organisme pour un peu plus de 2000 élus. Contrairement au caractère relativement similaire des thématiques de formation proposées (principalement tourné autour des questions d’urbanisme, de finances et de communication), il ne s’agit pas d’un marché homogène.
D’un point de vue géographique, d’après le rapport d’activité 2021 du CNFEL, une grande partie des organismes de formation agréés se situe en Région Ile-de-France. D’un autre côté, dix-huit départements ne comptent aucun organisme agréé sur son territoire et plus d’une cinquantaine n’en dispose que d’un seul. De ce fait, selon leur emplacement géographique, les élus locaux n’ont pas tous accès à une offre de formation de proximité. Ce qui complexifie d’autant la mise en œuvre d’un régime d’injonction. Car au-delà de la présence effective d’un budget de formation dans la collectivité, les élus locaux ne disposent pas des mêmes opportunités de choisir leur formation. D’autant plus que selon le type d’organisme auquel ils ont finalement accès, la qualité et le contenu peuvent fortement varier.
Schématiquement, il existe trois types d’organismes agréés : les associations d’élus (qu’elles soient généralistes, thématiques ou partisanes), les entreprises privées (SA, SARL, EURL etc.) et les établissements publics (universités, grandes écoles etc.). Les associations locales de maires et autres agences techniques départementales proposent généralement des formations de type « informatif » ou « d’échange entre paires » à des prix très bas (voir gratuitement) pour un nombre d’élus parfois important. Les établissements publics s’emploient eux généralement à décliner leurs offres pédagogiques pour proposer des parcours diplômants ou certifiants. D’autres structures associatives ou entrepreneuriales proposent des formations aux élus dans un esprit de formation professionnelle continue, tandis que d’autres le font sous des registres plus militants ou engagés. En tout état de cause, les formations proposées, sans dire qu’elles ne répondent pas chacune à des besoins légitimes exprimés par les élus, respectent des standards pédagogiques de nature diverse et ne peuvent que très difficilement être reconnues comme équivalentes en termes d’apprentissages effectifs.
Cette disparité entre les offres se confirme d’autant plus suite à la réforme de 2021 qui scinde le marché en deux parties. D’un côté, les organismes qui génèrent annuellement plus de 150 000 € de chiffres d’affaires via le DFEL et/ou DIFe sont tenus à partir du 1er janvier 2024 de se déclarer auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour y être reconnus comme des organismes de formation professionnelle et satisfaire à la certification Qualiopi. De l’autre, les organismes générant moins de 150 000 € de chiffres d’affaires annuels échappent à ces conditions et peuvent continuer de proposer des offres de formation ne répondant pas aux mêmes critères.
Cette situation pose un double problème. Pour les organismes concernés par l’obligation Qualiopi, les formations sont désormais organisées dans un cadre où les élus sont considérés par défaut comme des professionnels. Il s’agit alors de créer des formations autour d’objectifs pédagogiques évaluables tout en standardisant des procédés de travail permettant de répondre aux multiples critères du référentiel Qualiopi sanctionnés par des audits de suivi et de renouvellement tous les 18 mois. De ce point de vue, au travers de ces organismes, la formation des élus locaux se professionnalise. D’un autre côté, en plus des inégalités géographiques et de moyens, les élus locaux subissent un marché à deux vitesses entre des organismes pris dans des contraintes « qualités » et le reste des organismes de formation non soumis aux mêmes obligations.
Cette introduction de dispositifs de contrôle issus de l’univers de la formation professionnelle continue pour certains organismes est une réponse gouvernementale aux diverses dérives qui ont pu exister sur le marché de la formation des élus (et qui peuvent encore continuer par ailleurs). Par exemple, faute d’encadrement, les organismes étaient libres de proposer les tarifs de leur choix. Ils pouvaient également faire passer des sessions d’informations, de sensibilisation, des repas, des réunions politiques, des universités d’été etc., comme des formations et les faire financer à ce titre. D’autres encore utilisaient la stratégie du « porte-avion ». Ils se faisaient agréer par le CNFEL pour entrer sur le marché et monnayaient la sous-traitance de leur agrément à des organismes non certifiés pour qu’ils accèdent aux élus.
Ce qui a permis ces dérives, c’est qu’entre les années 1990 et 2021, le CNFEL ne disposait d’aucun moyen pour surveiller les organismes de formation et la qualité des formations réellement proposées (outre les procédures de renouvellement). L’audit conjoint de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) en 2020 en fait le constat explicite :
« Il n’existe pas de véritable gouvernance de la formation des élus. La DGCL et le CNFEL n’ont aucune information fiable sur les formations financées par les collectivités, qu’il s’agisse de données permettant de quantifier l’activité (organisme de formation ; intitulé de la formation ; élu formé ; coût de la formation etc.) ou d’en apprécier la qualité (évaluation par les élus ; contrôles sur place) […] Ainsi, une fois l’agrément obtenu, l’organisme de formation agit librement pendant deux ou quatre ans, sans que son activité soit contrôlée. Même au moment du renouvellement, l’examen du dossier est davantage formel que qualitatif. »11
C’est pour répondre à cet enjeu que de nouveaux dispositifs de contrôle, à l’instar de la double tutelle des organismes de formation les plus importants, ont été importés. Désormais, les organismes agréés doivent remettre un rapport annuel au CNFEL faisant état de leur activité de l’année passée, le CNFEL détient la possibilité de suspendre ou retirer un agrément, un Conseil d’orientation se trouve annexé au CNFEL pour alimenter un référentiel des formations pour les élus, une limite de prix de 80 € par heure et par élu a été imposé pour le DIFe.
Si tout cela semble aller dans le bon sens, plusieurs critiques restent tout de même très actuelles.
En 2021, pour que la plateforme du DIFe soit mise en fonction, un référentiel par défaut a dû être créé par la DGCL pour permettre aux organismes de classer leur formation dans le logiciel. Deux ans plus tard, le référentiel officiellement rendu par le Conseil d’Orientation se révèle identique au premier, comme si aucune des discussions et débats tenus dans cette instance n’avait eu d’effet ou d’importance.
De même, il est difficile de concevoir comment le secrétariat du CNFEL peut, chaque année, analyser en profondeur et de manière exhaustive l’ensemble des 240 rapports envoyés par les organismes pour y repérer des anomalies. Il est plus plausible que le rapport soit, en lui-même et indépendamment de son contenu réel, un élément de preuve opposable aux organismes ne jouant pas le jeu pour suspendre ou ne pas renouveler l’agrément.
De manière plus générale, alors que la réforme de 2021 impose à une partie des organismes de se professionnaliser, ces mêmes organismes voient leur chiffre d’affaires diminuer. En cause, l’évolution entre un DIFe calculé en heure et cumulable sur tout le mandat (120 heures en tout) et un DIFe calculé en euros (400 € par année) et rapidement bloqué (800 € actuellement). Ce changement bouleverse les modèles économiques jusqu’à générer parfois des cessations d’activités (comme l’entreprise VIATIC dernièrement). Dans ce cadre, une petite cinquantaine d’organismes de formation, principalement des entreprises impactées par la modification du DIFe, ont créé en 2021 la Fédération Nationale des Organismes de Formation des Élus Locaux (FNOFEL) dans l’objectif d’agir comme un groupe d’échange et de lobbying auprès du gouvernement et des parlementaires. Les différentes fins de non-recevoir reçues par leurs différents interlocuteurs gouvernementaux ou ministériels laissent à penser qu’en l’état, le marché de la formation des élus locaux n’évoluera pas de manière significative, malgré la volonté affichée par la ministre Dominique Faure, en lien avec l’AMF, d’annoncer un « véritable » statut des élus locaux lors du congrès des maires à la fin de cette année.
Conclusion
À défaut de données exhaustives et régulièrement mises à jour pour étudier l’usage que font les élus locaux de leur droit de formation, il existe trois hypothèses, probablement interreliées, pour comprendre pourquoi seuls 3 à 5 % d’entre eux se forment chaque année. Premièrement ce faible recours serait provoqué par les dispositifs eux-mêmes dont la fonction tacite serait de limiter la demande d’un groupe social dont le système de formation n’est pas structuré pour répondre à une sollicitation massive.
Deuxièmement, une faible demande pourrait aussi correspondre à l’évolution sociologique du profil des élus locaux. La complexification des mandats aurait pour effet indirect de rehausser les critères de recrutement des élus qui arriveraient en mandat déjà formés pour endosser le rôle et/ou pouvant se satisfaire d’un apprentissage « sur le tas » (Lagroye, 1994). Troisièmement, au-delà de la rhétorique qui en fait un outil de réenchantement de la démocratie locale, la mise en œuvre de la formation des élus locaux pose problème en ce qu’elle remet en cause le caractère autosuffisant de la citoyenneté pour l’engagement électif. Impossibles à définir clairement, les dispositifs de régulation déployés par le CNFEL ne pourraient pas s’appuyer sur des critères stables et objectifs permettant à un véritable marché de s’établir dans les proportions et selon les attentes et besoins des élus.
Pour étudier la validité de ces hypothèses, il est nécessaire de disposer de données. C’est dans cet esprit que l’Observatoire National de la Formation des Élus Locaux (ONFEL) a été créé en septembre 2023 ; pour valoriser les recherches académiques sur le sujet, créer des lieux et opportunités de dialogues entre les différents acteurs du marché (DGCL, CNFEL, CDC, FNOFEL, organismes, chercheurs etc.) et produire un baromètre de la pratique de formation des élus locaux. Produit de manière annuelle, son objectif serait de mettre à disposition, de manière publique et gratuite, les connaissances nécessaires pour comprendre la pratique de formation des élus locaux et des leviers pertinents pour agir en vue de sa démocratisation.
Sur le sujet beaucoup de travail reste à faire. Car, la démocratie française ne sera véritablement décentralisée qu’à la condition de repenser (a minima) la rémunération et la formation de celles et ceux chargés de prendre en charge ces compétences. Sinon, c’est à l’émergence d’une nouvelle classe notabiliaire que nous assisterons, déclinaison d’une épistocratie locale, de celles et ceux qui disposent des ressources et dispositions nécessaires pour s’investir en mandat contre le reste des citoyens, privés de ces moyens ou des possibilités de les acquérir.
Notes de bas de page
1 Chaque année, les collectivités locales doivent inscrire un budget de formation pour leurs élus se situant entre 2 et 20% de l’enveloppe indemnitaire maximale théorique.
2 Ce droit est administré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Chaque année, les élus reçoivent une enveloppe individuelle de 400€ dans la limite d’un plafond de 800€ accessible via la plateforme « moncomptreformation.gouv.fr ».
3 Aujourd’hui le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, mais historiquement le ministère de l’Intérieur
4 Le Conseil National de la Formation des Elus Locaux (CNFEL) est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur toutes les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément présentées par les organismes publics ou privés, quelle que soit leur nature juridique, qui souhaitent dispenser une formation liée à l’exercice du mandat des élus locaux. En 2023, le CNFEL se compose de vingt membres, nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales : dix élus locaux représentant les différentes catégories de collectivités locales et dix personnalités qualifiées. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans, renouvelable. La présente enquête, menée de 1993 à 2016, couvre ainsi 7 mandats pleins.
5 Comme l’Association des Maires de France (AMF), l’Assemblée des Départements de France (ADF) ou encore, l’Association des Régions de France (ARF), etc.
6 Ce bornage chronologique (1994-2016) représente la période sur laquelle les archives ont été recueillies et recouvre l’exercice plein de sept mandats de trois années.
6 Ce bornage chronologique (1994-2016) représente la période sur laquelle les archives ont été recueillies et recouvre l’exercice plein de sept mandats de trois années.
7 Ce qui entraine une observation intéressante ; les élus en situation de cumul de mandat vont préférentiellement utiliser leur droit de formation dans la collectivité disposant des moyens les plus importants.
7 Ce qui entraine une observation intéressante ; les élus en situation de cumul de mandat vont préférentiellement utiliser leur droit de formation dans la collectivité disposant des moyens les plus importants.
8 Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et Administratives. Acar Bruno, Giguet Xavier, Morin Gabriel, Schechter François, « la formation des élus locaux », IGAS-IGA, janvier 2020.
9 Par exemple, tous les élus avec des patronymes composés n’étaient pas reconnus au début de l’année 2022 par la Caisse des Dépôts et Consignations en leur qualité d’élu et ne disposaient d’aucun droit. Encore aujourd’hui, se problème existe pour les élus primo-accédants.
10 Ordonnances des 20 et 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
11 Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et Administratives. Acar Bruno, Giguet Xavier, Morin Gabriel, Schechter François, « la formation des élus locaux », IGAS-IGA, février 2020 P. 31. URL : file:///C:/Users/Acer/Downloads/19086R__formation%20%C3%A